|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
www.airetcolonnes.com LANDSCAPE ART - Les colonnes flottantes de Jean Moré |
|
|||||||||||
 |
 |
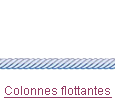 |
 |
 |
 |
 |
|
|
||||||
|
Jean Moré vu par... |
|
|||||||||||||
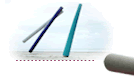
► Tym ► JFA
|
 |
SAMUEL DUDOUIT
JARDINS FUTURS RETROUVÉS
L’impossible,
Une saison en enfer
Des
colonnes flottantes : l’expression semble
déjà receler en elle-même un
paradoxe. La pesanteur et l’ordre d’un
côté, la mobilité et le vent de
l’autre.
Ces deux mots associés parlent d’architecture tout
en en donnant une idée
légère. De l’architecture, on a
pourtant rarement cette idée. Difficile, en
effet, d’oublier que
« l’architecture, pour Bataille,
c’était la
chiourme » comme le rappellent Sollers et Porzamparcet
qu’en elle s’est presque toujours
manifesté la volonté d’emprise du
pouvoir.
« il faut que tous les hommes sachent que le pouvoir
est là, et que la vie
est dure. » disent-ils encore de manière
saisissante.
Devant
les colonnes flottantes de Jean Moré, on pense
inévitablement à une
architecture nouvelle, ou à des vestiges très
anciens en train de sortir de
terre, de s’élever en une assomption muette. En
elles, le temps de leur
érection, le futur et le passé le plus ancien
semblent se rejoindre quelques
instants et le temps est passagèrement doublé par
leur architecture édénique. On
pense à la toile de Malevitch : Peinture
suprématiste (Huit rectangles
rouges) de 1915, ou à cette autre : Peinture
suprématiste de
1917 – 1918 où un figure d’un jaune
doré paraît s’envoler sur le fond blanc.
Jean
Moré n’est cependant pas un primitif, il vient
après Brancusi, après Warhol,
après le Déluge et l’Apocalypse. Il y a
longtemps que la Terre s’est effondrée
sur elle-même, longtemps que le ciel brûle,
longtemps que
le Temps est devenu
un enfermement, longtemps, enfin, que Chaos et Cosmos se sont
mêlés et que le
« transcendant »
s’est réfugié à des niveaux
atomiques.
Tout
se passe comme si, Brancusi post-Warhol, Jean Moré
retrouvait, de l’autre côté
du Déluge, cette fraîcheur inouïe qui du
profane permet de refaire du sacré.
Fraîcheur immémoriale surgie invisiblement au
milieu des ruines désormais
perpétuelles de l’Histoire contrainte à
ne pas cesser de finir, fraîcheur qu’il
faut saisir clandestinement (clandestinement à toute
clandestinité, autrement
dit d’une manière librement libre), ni au-dessus,
ni au-dessous, mais
transversalement au temps, quadrillé et enfermé
dans son accélération, de
l’Histoire.
Est-il
fortuit, innocent, hasardeux, enfin, que Brancusi, en voyage aux
États-unis en
1939 (pour l’exposition
Art in
our time
qui célébrait le dixième
anniversaire du MOMA), imagine pour la ville de Chicago un gratte-ciel
de 400
mètres sur le modèle de la colonne sans fin et
que Jean
Moré, de son côté,
quelques 60 ans plus tard, se plaise à penser (questions
techniques et
financières mises à part, comme Brancusi)
à des
colonnes beaucoup plus grandes
se levant toutes ensemble en divers points du globe comme pour
signifier la
puissance de la légèreté et du
désir face
à la volonté funèbre d’en
finir avec
la liberté clouant corps et temps sur une même
croix ? Comme s’il avait
senti, mine de rien, dès 1998, qu’il faudrait
bientôt penser et proposer
quelque chose qui aille au-delà des Twin Towers.
A
cette volonté effrénée de
destruction qui déferle aujourd’hui, opposer
l’efflorescence impudique des
colonnes flottantes revient à noyer d’un coup le
ressentiment dans un satori
insaisissable de satisfaction, de jouissance imperceptible,
à pratiquer une
acupuncture immédiate des nerfs et de
l’âme.
C’est
pourquoi, je le dis, Jean Moré devrait être
remboursé par la sécurité sociale,
ses colonnes flottantes disponibles en pharmacie et leur contemplation
solitaire, silencieuse, prescrite sur ordonnance.
A
bien les regarder encore une fois pourtant, il semble que si ces
colonnes (de
toutes tailles, de toutes courbures et de toutes couleurs)
recèlent la moindre
violence en elles, c’est encore du bâton avec
lequel le maître zen vient
frapper sur la tête de ses disciples pour provoquer en eux
l’éveil qu’elles se
rapprochent le plus.
J’ai
vu les colonnes de Jean dans son jardin, à la fin
d’un jour d’été, dans la
lumière rasante, dorée, qui venait filer sur la
cime des arbres ; je les
ai vues aussi sur une place, une nuit d’hiver, monter dans
l’air froid et le
vent qui soufflait du port leur blancheur étrange. Chaque
fois, sous la coulée
lente et profonde du moment qui me traversait rêveusement,
c’était un choc de
douceur abrupte, le commencement de quelque chose dont la
durée tombait à pic
sur le temps où je me perdais de vue à chaque
instant, ce temps où tous autour
de moi (et j’étais dans ces tous)
n’étaient que hoquets de négation
enfilés
dans les heures. Chaque fois, cette durée abrupte du
commencement c’était la
« verticale vive » où
« je » me jetait comme un
dé.
Car
c’est bien ce que l’irruption de ces colonnes dans
le paysage provoque sur le
regardeur, le passant, un choc en retour : c’est sa
propre présence, non
seulement inexplicable, improbable, injustifiable, mais bien
plus : donnée,
gratuite, qui fait irruption en lui. Chaque fois, devant les colonnes
flottantes, je suis là, sans savoir qui je suis, simple
question posée à elle-même, comme
dédoublée à
l’intérieur du choc, pourvue comme unique
profondeur, comme unique volume, comme unique corps, du seul
tremblement opéré
par l’écho de cette question en
elle-même. Présence tremblée, flottante
elle
aussi, à peine posée, attachée au sol,
à la limite du déracinement. Les colonnes de Jean Moré sont à l’image de qui est soudain invité à les voir comme le commencement de sa propre vision et de son propre corps : vide dressé sur lui-même, vibrant, se découvrant soudain présent là, saisi soudain par une stupeur d’être sans explication, car comme les roses, comme les fleurs, comme tous les objets quand ils nous parviennent dans la lumière de leur rêve, ce rêve auquel par instants, toujours imprévus, imprévisibles, le plus souvent insaisissables, nous accédons comme à un éveil (une porte s’est ouverte, un courant est passé, a tout rendu au dehors, soi compris, soudain étrange et proche à la fois, autre que moi, instants extrêmes qui s’ouvrent comme de corolles), les colonnes sont sans pourquoi et c’est l’abrupt de l’éveil et sa douceur radicale qui passe en nous de leur envol. C’est cette éclosion brute de l’ouvert, de ses nuances infinies qui est alors saisi, comme un repli de temps non encore habité, neuf.
Reste
à faire l’expérience. Tout nous en
détourne. Tout est fait pour qu’elle
n’ait
pas lieu, qu’elle reste hors saisie, qu’elle soit
étouffée. Cette expérience
qui fait écrire à Sollers :
« La sensation principale, elle, était
d’être traversé par une colonne
transparente, un rouleau de certitude, prends
ça ou ne le prends pas, au choix ».
On songe aussi à la formule de Michaux,
équivalent écrit d’une de ces colonnes
que Jean avait fait surgir dans son jardin : transparente,
laissant, à
travers elle comme à travers un prisme, se
décomposer la lumière du jour, donnant
accès à un espace apparemment
dénué de tout ressentiment contre soi et le
temps,
ouvert à une innocence qui reviendrait de loin, de
l’autre côté du
Léthé de la
dette.
«Je
me suis construit sur une colonne absente»
écrivait Michaux. Les colonnes
de Jean Moré, absentes de se présenter
à nous comme l’ouverture même du lieu
à
ce que nous sommes, comme l’ouverture même du lieu
que nous sommes de l’autre
côté de l’enfermement, ses colonnes en
se posant dans le paysage comme un
collage improbable ouvrent le lieu à un autre temps que
celui qui nous mène,
celui du calcul. Un temps ouvert sur lui-même, tout en
pulsations et en
détours, en replis et en étirements qui serait
l’ouverture même de celui qui,
devant ces colonnes, s’est
tout
simplement
laissé à ce qui est là, au
plus proche, de celui qui, sans abolir la distance a su se faire le
tympan
déchiré de ce qui vient
d’apparaître : le lieu rendu à
sa libre
apparition.
Là
où l’homme nouveau, enfermé en
lui-même, n’a plus même à
faire avec le vide
très présent de son absence, où,
ignorance de l’ignorance, absence de l’absence
même, misère redoublée, des chemins de
Damas par millions passent à chaque
instant tout autour, délaissés, non vus, Jean
Moré ne travaillerait-il pas à
fabriquer de l’homme ancien, immémorial, celui
qui, pour la première fois,
devient soudain homme en sortant de lui-même ? Comme
si au milieu des
images, du virtuel proliférant, les colonnes
étaient la marque de la vérité de
l’espace, comme si l’injection (même
instantanée) du temps à
l’intérieur du
sujet qui passe là, et qui, de fait, apparaît
là, rendait à l’espace sa
réalité, non pas sa réalité
écrasée, rabattue, arraisonnée, mais
son vertige de
réel au-delà de toute représentation
possible. 

Je
me suis demandé si les colonnes de Jean Moré
n’étaient pas comme le négatif, le
renversé de l’arbre du jardin d’Eden.
Une sorte – nouvelle – d’arbre
à refaire
du lieu le jardin, une
« machine » à faire du
jardin. Je me suis
répondu oui tout en songeant que s’y abandonner,
c’était aller vers cette
innocence dont personne ne veut, c’était entrer
dans sa révolution sans terreur
où le « tout autre »
n’est perceptible, ne dépend que de la vision du
sujet, de sa capacité à se retrouver intact dans
la fraîcheur de l’instant.
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
© 2005 - Jean Moré - www.airetcolonnes.com - Tous droits réservés |
|
|
||||||||||





 Les
colonnes de Jean Moré ont bien une fonction cosmologique et
sotériologique mais
d’un cosmos, d’un salut
d’après la catastrophe, concentrés
à la pointe fragile
d’instants de présence
déchargés de tout cadavre. Le lieu est partout,
comme le
salut, mais sans garantie de survie, sans continuité, sans
assise sûre.
Changeants, lieu et salut offrent une prise considérable au
vent et à sa
salubrité, comme ces colonnes qui, non contentes de ne plus
contenir le moindre
atome funèbre, flottent parfois sur l’eau, mais
aussi dans l’air et vont
parfois jusqu’à s’envoler.
Les
colonnes de Jean Moré ont bien une fonction cosmologique et
sotériologique mais
d’un cosmos, d’un salut
d’après la catastrophe, concentrés
à la pointe fragile
d’instants de présence
déchargés de tout cadavre. Le lieu est partout,
comme le
salut, mais sans garantie de survie, sans continuité, sans
assise sûre.
Changeants, lieu et salut offrent une prise considérable au
vent et à sa
salubrité, comme ces colonnes qui, non contentes de ne plus
contenir le moindre
atome funèbre, flottent parfois sur l’eau, mais
aussi dans l’air et vont
parfois jusqu’à s’envoler.

